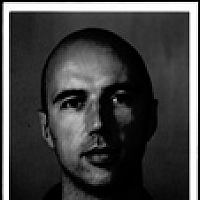Nous sommes traversés par de nombreux états quand les photographies sous nos yeux déroulent, révèlent dans l’apparition de leur sujet, une étrangeté familière. Les conditions pour que le familier devienne étrangement inquiétant sont la mise en présence de ce qui depuis longtemps est connu
avec ce qui depuis longtemps est familier, de ce côtoiement une faille s’ouvre dans la perception du
réel : L'illusion du tranquille.
François Deladerrière, en possession d’une chambre 4x5 inch, une mécanique en voie d’oubli, enregistre le repos de l’objet, cet état où dans l’immobilité et la fixité se pose la question de la fonction. Les lieux de ses repos ont été traversés par des corps qui ont laissé leur marque, leur empreinte mais qui ont déserté les sites. Nous voyons les restes, l'après, déposé en un temps de science fiction hors code, nous décryptons à l’aveugle, à tâtons, nous fouillons dans notre mémoire pour reconstituer ce qui a présidé à ces dépôts. François explore les épisodes d’un monde organique en travail, l’effacement est à l’oeuvre, les vestiges abstraits de l’industrialisation se consument sous le recouvrement tranquille du suintement du temps. Il y a aussi l’ombre, l’obscur qui enlacent ses photographies, qui pourtant foisonnent de détails, de définition selon le terme attribué à la qualité des objectifs, mais cela ne suffit pas à expliquer la nature des choses. La précision échoue pour évoquer le trouble immobile, énigmatiquement laconique des lieux de Deladerrière. L’ombre dans ce qu’elle dissimule sous son épaisseur et son humidité souligne l’épaisseur de l’air qu’il a fallu déchirer pour faire apparaître ces scènes. Cernés par des cadrages centrifuges, ces décors sans mise en scène attendent la mise en couleur qui les ramènera dans le réel. Le monochrome domine le silence de ces lieux, il augmente le sentiment d’arrêt sur image, il impose son temps à notre regard, contrarie et déconnecte nos repères. François Deladerrière photographie entre chien et loup juste avant que la dernière séance n’ait lieu, et que l’oubli ne passe.
Géraldine Lay ne nous laisse pas de choix, nous devons nous en remettre à elle, lui céder et parcourir ce qu’elle nous propose comme une réalité. Celle d’un monde qui se met en scène, ses personnages sont âgés, leur vie est suspendue et la pose immuable. Jamais les regards ne se croisent, chacun interroge un au delà du cadre ou de soi, ce qui revient au même. Tout est en place dans l’équilibre ultime qui précède l’écroulement, la catastrophe post-déclenchement. La tranquillité pesante domine. Dans chaque photographie de nouvelles situations jouent, répètent, nous imposent l’idée d’une inéluctable fatalité : celle qu’arrêter intentionnellement le déroulement
de la durée débouche paradoxalement sur un vide en attente... Géraldine consigne ces vides au fil des photographies, elle les dépose sur l’écran de ses tirages, elle les encercle de lumière mordorée, les égratigne de couleur. Le retour obstiné de ses plans de coupe nous met dans le même état que les rêves récurrents, nous sommes face à l’étrangeté de ce qui se répète. La fascination des associations, des rencontres qui font glisser le réel vers l'irréel, travaillent la matière de ces failles
ordinaires. Ainsi un enfant assis devant un drapé rouge dans son cadre doré nous regarde en face, le seul écran qui nous sépare de lui est celui des flocons de neige, son rêve est de devenir marin, lui qui tient fermement un petit bateau de bois dans sa main droite, et pourtant il est à jamais amarré au cadre de la peinture qui l’enferme. Cette peinture scellée au sol du parvis d’un musée est la faille, le passage dans le monde de Géraldine Lay.
La fiction se tisse entre les photographies des corps, les paysages miroir, les natures mortes. Le vide en attente de chacune met en écho l’inquiétante étrangeté qui ne s’éteint jamais tout à fait.
Jacques Damez, 2 janvier 2009