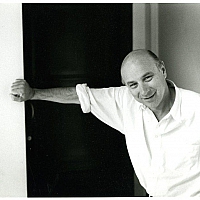© Alice Springs
Maison Européenne de la Photographie 5, 7 Rue de Fourcy 75004 Paris France
Alice Springs
« Quand elle a commencé à faire de la photo, j’étais un peu septique. Ses premières œuvres étaient très prometteuses et elle prenait un immense plaisir à photographier ses amis, mais je connaissais la chanson et je savais que la photographie est un art d’une simplicité trompeuse. On a la chance du débutant, puis on apprend les rudiments de la technique, quelques trucs et astuces, et la spontanéité disparaît.
Mais ce ne fut pas son cas. Sa technique n’est pas devenue irréprochable, même après tant d’années, mais cela suffit. Alice prend rarement plus de deux ou trois pellicules, par crainte d’abuser de la patience des gens. Elle n’utilise aucune ficelle du métier, car elle ne les connaît pas. Elle préfère photographier sans détours les personnes pour qui elle éprouve de l’intérêt ou de la tendresse. Le résultat est souvent remar- quable. Elle n’a pas son pareil pour les portraits.
Nul doute qu’il existe aujourd’hui de grands portraitistes dont l’œuvre a plus de poids, mais la sienne est unique en son genre. Ses portraits sont totalement innocents. Les rares fois où je l’ai regardée travail- ler, j’ai été sidéré par son absence de manipulation, par la façon dont elle se fondait dans le décor pour s’effacer totalement. Il arrive que certaines photos me soient familières sans que j’aie jamais rencontré les modèles. Quand je finis par faire leur connaissance, je suis tou- jours stupéfait de voir à quel point le portrait m’en a dit long sur la personne. » Helmut Newton
En 1970, June Newton commence une carrière de photographe sous le pseudonyme d’Alice Springs. Depuis 2005, ses travaux sont régulièrement exposés à la Fondation Helmut Newton à Berlin, dans la salle baptisée « June’s Room ».
Cette rétrospective, exposée auparavant à Berlin et Milan, rend compte de 40 ans de travail et présente à la fois ses photographies de publicité et de mode ainsi que des nus et des portraits.
L’épouse d’Helmut Newton a entamé sa propre carrière photographique à Paris en 1970. Son mari, alors alité avec la grippe, lui apprend à manier son appareil et son luxmètre, pour qu’elle puisse réaliser à sa place une photo publicitaire pour la marque de cigarettes Gitanes.
Le célèbre portrait qui en résulte sera le point de départ de sa nouvelle carrière. à Paris, cette actrice de théâtre d’origine australienne avait dû renoncer à sa carrière et s’était investie dans la peinture, avec les pinceaux et les couleurs que son mari lui avait donnés. Mais après cette fameuse photo publicitaire, José Alvarez, alors directeur d’une agence publicitaire, lui passe une commande pour des campagnes pharmaceutiques.
Dès le milieu des années 70, Alice Springs reçoit de nombreuses commandes de portraits, dont certains deviennent légendaires. La multitude d’artistes, d’acteurs et de musiciens qu’elle photographie au cours de ces 40 dernières années est un véritable « who’who » de la scène culturelle internationale des deux côtés de l’Atlantique, d’Yves Saint-Laurent à Karl Lagerfeld, de Billy Wilder à Diana Vreeland, en passant par les Hell’s Angels.
La plupart de ces portraits sont des commandes pour des magazines publiés à Paris et à Los Angeles, d’autres résultent d’initiatives privées.
La majorité de ses modèles appartiennent à la jet-set internationale, mais Alice Springs porte cependant le même regard empreint d’innocence et de simplicité sur tous ses sujets. Elle révèle leur singularité, mais aussi leur vulnérabilité.
Ses portraits se distinguent par une approche intime et spontanée. Traduire l’intensité des telles personnalités artistiques ne peut se faire que grâce à son ouverture d’esprit, sa sensibilité et sa psychologie. On pourrait imaginer que ces célébrités se prêtent aux séances photos dans une incessante quête de notoriété. Mais en fait, une séance photo peut se transformer une sorte de duel entre le modèle et le photographe, dont l’appareil devient arme. Dans un portrait photographique, la force créatrice vient en second ; le photographe doit dépasser le simple document afin de créer une image nouvelle, imprévue, qui transgresse les stéréotypes. Alice Springs y réussit à maintes reprises dans ses portraits. C’est peut-être sa connaissance du théâtre qui l’amène à voir au-delà de l’être humain, en particulier dans ses doubles portraits qui mettent subtilement en scène l’interaction des protagonistes.
Alice Springs fait plus que capter l’apparence de ses contemporains, célèbres ou anonymes ; elle canalise leur charisme, leur aura. Derrière ses magnifiques portraits, se dessine une connivence implicite, une complicité spirituelle. Son regard se concentre surtout sur le visage ; parfois, elle rétrécit le champ pour s’attarder sur un détail, généralement les mains. Dans ses petits formats, les sujets nous regardent de manière directe, curieuse, candide — ce qui est rare dans la photographie contemporaine.
Peu de ses portraits sont réalisés en atelier, la majorité est prise dans des espaces publics ou dans la maison de ses sujets. Il règne un sentiment de familiarité, entre distance et intimité. Les poses sont rarement affectées ; les prises de vue se font avec simplicité.
La photographe ne trahit jamais son sujet.
Au début des années 1970, Alice Springs s’est vu confier plusieurs campagnes par le coiffeur Jean-Louis David ; ses photographies apparaissent sous son propre nom, dans des publicités en pleine page publiées par de grands magazines de mode, tels que Elle, Vogue, Marie Claire et Nova. Elle commence également à travailler pour le magazine Dépêche Mode en 1971 et, trois ans plus tard, fait pour la première fois la couverture de l’édition française du magazine Elle.
Certains de ses premiers travaux de mode et de publicité sont présentés au début de cette rétrospective, qui comporte également les nus provocateurs qu’elle a réalisés dans les années 70. Matthias Harder,commissaire Avec la Fondation Helmut Newton, Berlin
© Alice Springs
Cédric Delsaux
Dark Lens
Depuis la première révolution industrielle, au 19e siècle, le développement de la technologie « soumise aux impératifs du calcul marchand » a entraîné un rapport de plus en plus astreignant au temps, ce qui nous conduit bien souvent à penser, bien qu’il soit impropre de le formuler ainsi, que le temps « s’accélère ». Comme le souligne l’essayiste américain Jeremy Rifkin — spécialiste de prospective économique et scientifique — au cours de notre histoire, « la densification de nos échanges nous a conduit à organiser notre temps en plus petits segments : d’abord en heure à la fin du Moyen Age puis, au début de l’ère moderne, en minutes et en secondes ».
Aujourd’hui, avec la troisième révolution industrielle, celle des technologies de l’information et de la communication, « on crée de nouvelles valeurs temporelles : la nanoseconde et la picoseconde ». Organisant désormais notre temps à la vitesse de la lumière, avec des unités temporelles qui sont bien en deçà de notre seuil de perception, nous sommes contraints de « dissocier l’expérience humaine de la vitesse de communication à laquelle les informations peuvent être transmises. Ce qui est très aliénant ». Nous mettons en place, dans notre réalité objective comme dans notre imaginaire collectif contemporain, les conditions de notre total assujettissement à la machine.
Il semble donc que ce soit pour conjurer cet asservissement par la vitesse et la technologie que Cédric Delsaux nous invite à faire un pas de côté, dans un futur antérieur ou un présent contrefactuel qui a tout simplement rayé l’humanité de la carte.
Dans la série « Dark Lens », à la fois familiers et troublants, plantés dans le décor de notre contemporanéité, les personnages de la saga Star Wars sont socialisés dans la banalité de notre quotidien hyper urbanisé ou dans l’environnement glauque de zones post-industrielles en déshérence. Ils perdent de leur aura mais acquièrent une inquiétante étrangeté, semblant tourner à vide avec une violence sans destination.
Si Star Wars est la fresque flamboyante d’une démocratie intergalactique qui a mal tourné, « Dark Lens » opère quant à elle un glissement contextuel qui sonne comme un avertissement. Le jeu de miroir de ce pouvoir technologique dictatorial déjà obsolète est saisissant et nous fait entrevoir un devenir fictionnel mais néanmoins possible sous la forme d’une archéologie du pire. À mi-chemin entre la mémoire cinématographique, la stase de l’image photographique et les projections dystopiques qu’impriment le développement des mégalopoles sur nos esprits synchronisés par la globalisation,
« Dark Lens » met en scène un miroitement de temporalités multiples orchestré par l’ancrage du temps présent de notre regard. Contempler ces images fixes suppose de prendre son temps ; ce temps à échelle humaine, condition de notre interprétation du monde. Jean-Luc Soret Commissaire d’exposition

© Cédric Delsaux
Choi
Sténopés
Le public de la Maison Européenne de la Photographie avait découvert sa série tourmentée « Autoportraits en enfer », exposée en 2005.
Plasticien inspiré, Choi doit sa célébrité à une longue et féconde expérience de tireur au service d’une pléiade de photographes contemporains nommés Newton, Goldin, Tosani, Moulène, Bannier, Rheims, Orlan, Dine, d’Orgeval ou Poitevin, parmi beaucoup d’autres.
Choi Chung Chun (mais on dit « Choi ») est né à Hong Kong en 1949 et a commencé son apprentissage en assistant son oncle photographe. L’adolescent qui rêvait de devenir peintre arrive à Paris en 1965 pour s’inscrire à l’école des Beaux-arts. Il a tout juste seize ans. Il en a dix-neuf quand il commence à travailler dans un laboratoire où il se perfectionne en tirage jusqu’à devenir un spécialiste du grand format. Après de longs passages en plusieurs entreprises, Choi décide en 2011 de s’installer en toute indépendance dans un des vastes locaux du complexe industriel CAP18, dans le 18e arrondissement, sous la simple enseigne d’Atelier Choi.
Réputé rare et brillant, Choi y reçoit ses clients photographes avec lesquels il entretient une relation de travail amicale et singulière, propice à la réalisation de tirages argentiques en noir ou en couleur, exécutés par un homme seul dans le gigantisme des formats et le volume d’expositions entières. Semblable aux grands artisans qui dans les pages de l’histoire de l’art servent le génie, Choi ne se repose d’un travail que par le commencement d’un nouveau projet.
Ces semaines de sept jours lui laissent pourtant le temps de produire une œuvre d’artiste et sa dernière production située à la convergence de la photographie et de la peinture s’expose à la MEP en vingt-cinq épreuves géantes des figures étranges, visages émergeant de limbes infernales ou célestes, réalisées chacune en plusieurs heures de pose en chambre noire, composant avec le froissement aléatoire du papier de riz, le recours prémédité aux opacités de pigments, pour inventer le détournement de l’immémorial sténopé. Hervé Le Goff

© Choi
Claude Nori
éditeur et photographe
Claude Nori occupe une place tout à fait unique dans l’histoire de la photographie française avec son œuvre de photographe qu’il pratique depuis 1968 mais aussi grâce aux éditions Contrejour qu’il fonda en 1975 afin de publier son premier livre.
Les éditions Contrejour permirent à une génération entière d’auteurs contemporains de s’exprimer pour la première fois à travers le support du livre qui constituait, avec les expositions, l’espace créatif original de la nouvelle photographie française.
Il remit en lumière les humanistes et quelques-uns des plus grands photographes français ou étrangers alors dans l’oubli (Doisneau, Sieff, Ronis, Plossu, Boubat, Ghirri, Le Querrec, Petersen, Giacomelli, Salgado...) fonda les revues les Cahiers de la Photographie et Caméra International, ouvrit une galerie, édita plus de 150 ouvrages, qui font encore référence aujourd’hui, se trouvant ainsi au cœur du grand chambardement qui conduisit la photographie à son âge d’or.
Conjointement, il n’a jamais cessé d’exercer son activité d’auteur- photographe par une succession de livres autour de ses sujets de prédilection : l’Italie, l’adolescence, la poésie balnéaire, une certaine recherche épiphanique du bonheur et de l’amour avec lesquels il a creusé le sillon de la « photobiographie ».
Cette exposition met en parallèle pour la première fois l’aventure éditoriale de Contrejour sur près de vingt ans autour de ses livres majeurs et l’œuvre personnelle de Claude Nori et restitue l’ambiance particulière de cette époque de fraîcheur et de découverte à laquelle participèrent de nombreux critiques, historiens ou écrivains, qui furent surtout des compagnons de route et des amis.

© Claude Nori