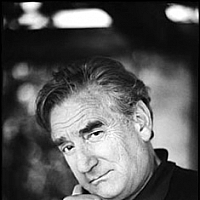© Willy Rizzo
Studio Willy Rizzo 12 rue de Verneuil 75007 Paris France
La rue Cambon, c’était un parfum.
Le N°5 qu’on vaporisait chaque matin, à l’ouverture. Une odeur de boudoir, d’amour. Et de ruche. Car chez Chanel, chaque abeille travaillait au service de la reine. Les vendeuses portaient du noir, les ouvrières et les mannequins entre les essayages, la blouse blanche. Et les clientes comme la « patronne », le tailleur en tweed que « Mademoiselle » s’acharnait à appeler « costume », un modèle presque unique, répété, copié, et pourtant toujours différent. Et ça faisait comme une armée, prête à marcher au pas, au moindre désir de son général. Mademoiselle...
A ma connaissance, il n’y en eût qu’une autre dans l’histoire de France. La cousine de Louis XIV, qui eut le culot de faire tirer au canon sur les armées de son roi. On l’appelait la grande Mademoiselle. La mienne était toute petite. Certains l’appelaient Coco, en souvenir du moineau qu’elle avait été. Ça ne me serait pas venu à l’idée. Mademoiselle était bien une reine.

© Willy Rizzo
Je l’avais connue à la fin des années quarante, chez les frères Mille, le décorateur, Gérard, et le journaliste, Hervé, bras droit de Jean Prouvost, l’industriel du textile tombé amoureux des rotatives. Les frères Mille fonctionnaient comme un piège inversé. Ils attiraient ce qui brille. Ce qu’il y avait de plus drôle, de plus beau, de plus intelligent à Paris. Dans leur salon de la rue de Varenne, le seul passe port obligatoire était la légèreté. Les années noires, on n’en parlait pas. Pour la fermeture de la maison Chanel, par exemple, l’exil en Suisse... on disait les « longues vacances »... Et cela me convenait à moi qui avait suivi le procès de Nuremberg, et avait décidé de toujours préférer les feux d’artifice aux ténèbres. Au point que j’avais d’abord tourné le dos à l’Europe. C’est la force de conviction d’Hervé qui lui avait fait renoncer aux paillettes d’Hollywood. Il avait prononcé les mots qui m’ont toujours jeté dans les avions : « c’est là que ça va se passer... » Avec Jean Prouvost, il lançait Paris-Match.
Les critères de recrutement étaient simples : être jeune, aimer sortir, avoir du talent. j’ai laissé tomber Los Angeles, ses stars, son soleil, pour Paris et ses tickets de rationnement. Je ne le regrettais pas. Les peintures s’écaillaient, mais la joie de vivre recouvrait déjà la grisaille. Dans la mode aussi, on avait tourné la page. Avoir été une gloire avant guerre n’était plus une référence. Il y avait eu Dior, le New Look. A côté, Chanel, ça sentait la poussière. Les longues vacances tournaient à la retraite définitive.
Qu’est-ce qui lui prit, en 1953 ? Ses 70 ans peut-être ? Mademoiselle explosa. Elle disait qu’on marchait sur la tête. Qu’il fallait être un homme pour croire que les femmes allaient se déplacer, déguisées en « montgolfière ». Qu’on avait oublié ses principes. Ses chers principes.
Comme on mise au casino, elle a tout joué sur le 5. Encore une fois. Le 5 février 1954, au 1er étage de la rue Cambon, les grands miroirs ont retrouvé la foule énorme de ceux qu’elle avait invités à son retour. Elle les avait conviés à son sacre. Elle n’avait pas deviné qu’ils avaient reniflé l’odeur du sang et s’étaient préparés pour une exécution : Mademoiselle fit un flop. On la disait finie. Mais ceux qui s’attendaient à la voir déguerpir ne la connaissaient pas. Elle prépara sa collection d’hiver avec obstination.
C’est là que je fus envoyé en commando. Pour sauver le soldat Chanel dans Match. « Tu auras le meilleur » m’avait dit Hervé. Mon premier reportage date du 14 août 1954.

© Willy Rizzo
Chez les frères Mille, j’avais connu la Chanel qui voulait qu’on la fasse rire. Je la découvrais sur son champ de bataille, elle exigeait du silence, de l’obéissance, de la discipline. J’ai eu le privilège de la voir manier ses armes, les ciseaux et les épingles. Elle demandait à ses mannequins, debout pendant des heures, de faire semblant de sauter sur une plate -forme d’autobus, ou de se glisser dans une voiture de sport. Le tissus devait suivre. « Ceux qui rient ont toujours raison ! » aboyait-elle. Et elle assenait les ordres : « enlevez moi ces chichis, simplifiez, dégagez le cou... » Elle avait son remontant : les clientes. La presse n’avait pas compris, mais les femmes, elles, passaient commande. Mademoiselle sentait le succès revenir sous ses doigts. Sa seconde collection fut un triomphe. Elle avait gagné.
Je me souviens d’une de ses phrases : « Le malheur, on le créée. Je ne fabrique que du bonheur ! ».
Voilà ce qu’elle m’a appris. Comme photographe ou designer. A fabriquer du bonheur.
Photos et vignette © Willy Rizzo