
© Antoine d’Agata - Magnum photos- Tokyo, 2008 Courtesy Galerie Les filles du calvaire, Paris
La propagande par le fait d’Antoine d’Agata
Le monde d’Antoine d’Agata est un monde de flux, flux d’images, de matières, de sensations et de sentiments… Devant ses images, on pense au début de L’Anti-Œdipe de Deleuze & Guattari : « Ça fonctionne partout, tantôt sans arrêt, tantôt discontinu. Ça respire, ça chauffe, ça mange. Ça chie, ça baise. Quelle erreur d'avoir dit le ça. Partout ce sont des machines, pas du tout métaphoriquement : des machines de machines, avec leurs couplages, leurs connexions. Une machine-organe est branchée sur une machine-source : l'une émet un flux, que l'autre coupe… »
Chaque image réalisée par Antoine d’Agata est une manière d’arrêt, de coupure dans un continuum de sensations, dans un écoulement sans fin de vie, d’émotions, de gestes, de situations… Chaque image est marquée au sceau de ce paradoxe : elle est à la fois un objet fixe et un prélèvement, une ponction… Les images d’Antoine d’Agata sont des précipités, au sens chimique du terme (en chimie, le précipité désigne en général la formation d'un cristal solide - d'un sel par exemple - au contact d’un liquide). Ses photographies sont des concrétions d’événements vécus, de séquences d’existence… D’Agata évoque ses images comme des restes, des vestiges d’actions ou de situations qui, elles, sont irreprésentables. Les seuls points de repère sont quelques images rescapées.1
Le processus mis en place par Antoine d’Agata s’appuie sur un point aveugle qui rend possible le récit photographique. Seul l’imaginaire dévoile l’impossible réel. Plus que d’une image en effet, il s’agit pour lui d’un récit. Le processus exige un sacrifice, action ultime dont le sens ne sera révélé que lorsqu’elle deviendra, par le geste artistique, histoire racontable, récit de flux et de devenirs perpétuels, de démesures, d’excès aveugles, de réalités individuelles, d’exploration des pulsions élémentaires de la nature et de l’humanité, de la tension permanente entre les forces irréconciliables de la raison et de l’instinct.

© Antoine d’Agata - Magnum photos- Sao Paulo, 2006 Courtesy Galerie Les filles du calvaire, Paris
Les photographies d’Antoine d’Agata ne sont pas des représentations, mais littéralement des morceaux arrachés. Chaque image est un arrachement plus qu’une construction ou une composition (d’Agata ne compose pas une image, il l’arrache à la réalité de sa propre vie). La chair est au cœur de ces images que l’artiste qualifie de « nuit ». Ses images sont des lambeaux de chair. Une chair aimée, triturée, violentée, droguée… Une chair traversée par les heurs et les malheurs des circonstances. Dans les entrailles de la basse ville, les corps mêlés se tordent, s’abîment dans un désordre sexuel et narcotique. L’entreprise insensée menée par l’artiste depuis plus de vingt ans doit aboutir à l’abolissement de la distance entre lui et ses modèles. Le désir de combler une distance absolue, la verge tendue dans le vide, l’appareil enregistre la même chronologie usée, la maladresse cède à la compulsion, technique de la débâcle. S’agit-il d’ailleurs de modèles? Toutes les femmes photographiées sont plutôt des complices, des partenaires de cette entreprise inouïe… Ce sont pour l’immense majorité des prostituées. Nous ne sommes pas pour autant ici dans l’esthétique des « femmes au bordel » (comme chez Lautrec, Degas, Picasso, Brassaï, ou, plus près de nous Jean-Luc Moulène ou Andres Serrano).
Les femmes photographiées ne sont pas des alibis esthétiques, mais des êtres avec lesquelles d’Agata entretient une relation forte, violente, mêlant de manière extrême expériences sexuelles et narcotiques. Les femmes rencontrées et photographiées participent toutes d’un même monde, au-delà de leurs pays respectifs, celui des marges du monde dit civilisé, là où règne une forme d’humanité paradoxalement préservée. Les zones de non-droit sont des territoires de tous les écarts, refuges de spécimen d’humanité blessée, espace clos et privilégié où la bestialité sape la bienséance et les règles sociales. Pas de complaisance ici, pas d’idéalisation, mais la prise en compte de faits bruts, frontaux. Antoine d’Agata n’occupe à aucun moment la position de voyeur, les femmes photographiées elles-mêmes ne se fourvoient jamais dans l’exhibitionnisme. La complicité de l’artiste et de ses femmes est d’une autre nature ; elle défie les figures imposées de l’érotisme et de la pornographie. C’est une quête cruelle et sans issue que d’embrasser la violence de la rue, d’en vivre l’expérience dans sa chair : apprendre le langage meurtrier qui dépasse toutes les poésies, traquer l’irruption de la vie, sale et brutale, dans l’ordre des convenances, chercher la vérité fragile des gestes, reconnaître la solidarité là ou d’autres voient un néant irrémédiable, se laisser submerger par la beauté intolérable des filles, s’enfermer dans la certitude d’une solitude radicale, se mettre à nu, confondu au monde physique qui s’efface dans un glissement, et payer le prix, jusqu’au sacrifice.
Antoine D’Agata n’a que faire de la forme. La seule forme qui vaille à ses yeux est celle qui arrive, celle qui se dessine, non au travers de son appareil, mais dans la vie la plus intime, celle qui survient et surgit du cœur de l’événement en train de se vivre. La photographie, dédiée jusque-là à l’exploration des dimensions du passé et de l’imaginaire, ne peut plus être qu’une affaire de gestes, art de la présence et de l’instant, subversif, asocial, érotique, amoral.
Antoine d’Agata est photographe à son corps défendant. Car il en montre physiquement la vacuité, mais il a conscience qu’il est lui-même partie prenante de ce processus, c’est-à-dire qu’il ne sort pas indemne au contact des images qu’il produit. Posséder le monde désiré à travers une image, sans exiger de son corps un travail destructeur, est une chimère.
A l’instar de Pierre Guyotat qui qualifiait son écriture de « prostitutionnelle », il est possible de parler de la photographie prostitutionnelle d’Antoine d’Agata. « N’est valide qu’un art nuisible, subversif, asocial, athéiste, érotique et immoral, antidote à l’infection spectaculaire qui neutralise les esprits et distille la mort. La photographie n’est donc pas cet art angélique et prophylactique qui nous mettrait à l’abri du bruit et de la fureur du monde, mais bien une expérience qui nous plonge et nous compromet dans les hiatus de notre réalité.
Il existe pour d’Agata une forme de transsubstantiation entre les gestes photographiés et le geste photographique lui-même (il y a du catholicisme qui transpire de ses images, comme chez Pasolini ou Caravage). La captation compulsive de ces réalités dérisoires et insaisissables, et leur restitution, se construisent sur les mêmes principes : encombrements, collisions, cul-de-sac, récurrences, raccourcis visuels et émotionnels où l’émotion déborde le non-événement. La photographie de d’Agata relève du rapt ; elle reste marquée par la violence chaotique des gestes effectués. Pas de contrôle, la photographie n’est là que pour enregistrer des intensités. Pure surface d’inscription, elle est cet objet ténu et dérisoire qui permet la transcription des gestes avec le moins d’écart possible. L’outil photographique dérisoire, brut, fragmentaire, mais seul art qui relie directement l’expérience à la conscience, met à jour ces tensions parce qu’il n’est pas contraint à l’épreuve d’une élaboration consciente. L’outil photographique porte en lui les germes de l’action, le geste équivalant à l’acte perceptif même : la photographie comme art martial dont l’unique principe serait le désir du monde.
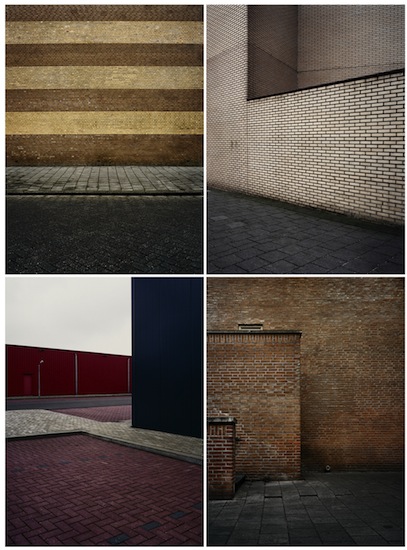
© Antoine d’Agata - Magnum photos - Croningen, 2003 Courtesy Galerie Les filles du calvaire, Paris
La photographie comme art martial : la formule est hardie, mais elle souligne bien la part de rituel qui préside à l’élaboration de ces images. Un rituel, c’est-à-dire, en l’occurrence, une exigence. Car il ne s’agit pas pour d’Agata de souscrire à quelque spectaculaire que ce soit. Michel Leiris parlait de « la littérature considérée comme une tauromachie ». Chaque image porte en elle le récit d’un risque. Les rituels de d’Agata ont une précision quasi tauromachique, même désir d’ « aller à la corne », de s’abîmer au péril de sa vie dans un échange qui n’a pas d’autre horizon que la présence d’un danger qui peut à tout moment s’avérer fatal, une même relation mêlée du trivial et du sublime. La défaite, la perte, le gaspillage immodéré, jusqu’à ce que dans la contraction infinie du temps, à travers une sorte de stoïcisme désespéré, attente et accomplissement, instant et durée, coïncident en un seul geste glorieux, nihiliste, vain, anonyme, maladroit, répété…
A l’instar de la tauromachie, le rituel « martial » de la photographie de d’Agata se voit confronté à d’autres rituels, moins glorieux et plus sordides. La seule exigence de l’artiste est de faire se compromettre son art (et de se compromettre lui-même physiquement et mentalement) avec la part maudite du monde. Car cette dernière porte en elle la vérité de l’humanité.
Antoine d’Agata prend délibérément « le parti du diable » (Guy Debord), qui lui permet d’être en prise avec le réel. C’est dans cette souffrance, sociale autant que sexuelle, qu’il puise son énergie. La souffrance engendre dignité, respect, solidarité, tendresse, conscience de classe, générosité qui s’inscrivent dans les mécanismes nauséabonds de la misère.
La photographie d’Antoine d’Agata est une œuvre politique, si l’on entend ce terme de manière non restrictive. En ce sens, on ne peut opposer ce qu’il nomme par commodité les « images du jour », liées à des contextes historiques et guerriers (la Libye, Auschwitz, le Cambodge…) et les « images de nuit », liées à ses errances sexuelles et narcotiques. En dépit de leurs différences formelles, ses images sont issues d’un même monde, celui de l’aliénation contemporaine. Mais peut-être, en vertu de leur caractère déterritorialisé, les « images de nuit » sont-elles plus saisissantes, et pointent en creux la servitude de notre temps de façon radicale, parce que moins littérale. La communauté hybride de ceux qui n’ont rien échappe malgré elle au rêve de la marchandise, aux impératifs de la consommation et à la parcellisation du réel ; elle redécouvre l’insatisfaction, se forge un destin propre pour s’inscrire comme sujet dans l’histoire, vivre dans l’infamie, se défaire de l’esclavage par l’assouvissement de l’instinct, refuse de fait de consentir à son exploitation pour se fondre dans une danse du sexe et de la mort.
Antoine d’Agata a part liée avec la population de ces zones déshéritées de la planète où se côtoient prostituées, souteneurs, dealers, délinquants et déclassés de toutes sortes… Aucune condescendance dans son regard ; aucune compassion non plus. D’Agata se sent appartenir à la même « sale espèce » (pour reprendre la formule de Michel Foucault) que ses partenaires photographiés. Les classes dites dangereuses, dégâts collatéraux du capitalisme contemporain (spectaculaire et mondialisé) portent en elles le ferment de la révolte à tous les ordres établis (économiques, raciaux et sexuels). Le capitalisme globalisé n’a ni fin ni frontière qui le restreignent et le pourrissement, fruit de la corruption inintégrée sur un mode organique aux normes de rendement, provoque l’émergence de trous noirs et attitudes déviantes qui sapent ses postulats moraux.
La sexualité est le lieu cardinal où s’aiguisent de façon exacerbée les contradictions de notre monde. L’obscénité des corps photographiés par Antoine d’Agata est à comprendre comme le contre champ (le contre-feu) radical d’une obscénité sociale et médiatique, autrement plus prégnante et redoutable. L’obscénité est dans l’hypocrisie des lois, l’abrutissement psychologique de la masse soumise, la limitation des mouvements de la chair au sein du champ social, la culture de la peur et de l’insécurité, l’étouffement planifié de l’expérience, l’infinité de technologies qui perpétuent l’autorégulation et la discipline de foules fascinées par le spectacle de leur asservissement et la promesse d’une félicité nouvelle.
Les photographies d’Antoine d’Agata sont en ce sens au plus loin du monde pornographique. Elles en sont même, au travers de leur crudité et de leur violence, la critique explicite. Face à l’oppression que génère l’abondance d’images stéréotypées, et leur démultiplication par les industries culturelles, face à cette pornographie généralisée, vivre devient le seul enjeu ; et la seule œuvre possible dont il peut être question est la perpétration d’actes insensés.
Face à la pornographie économique sociale et médiatique de notre monde contemporain, seule la « propagande par le fait » d’actes insensés est susceptible de fomenter de nouveaux troubles, c’est-à-dire de créer de nouvelles situations.
Bernard Marcadé
Photos et vignette © Antoine d'Agata - Magnum Photos


