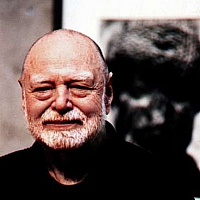Expositions du 30/09/2005 au 12/11/2005 Terminé
Box Galerie 102 chaussée de Vleurgat 1050 Bruxelles Belgique
En 1937, à peine âgé de 19 ans, il est né à Stockholm (Suède) en 1918, Christer Strömholm quitte la Suède pour Dresde où il integre l'école d'art du professeur Waldemar Winkler. En conflit avec le prefesseur au sujet de Paul Klee et des artistes interdits du Bauhaus, il part bien vite pour Paris, puis Arles, à la rencontre de son maître, l'artiste suédois, Dick Beer. C'est l'automne1938 qu'il rentre en Suède et commence la peinture avec Otte Sköld et Isaac Grünwald. en 1946, aprés avoir servi de 1939 à 1945 sous le drapeau norvegien dans un corps de volontaire puis dans la resistance, il revient à Paris et s'inscrit à l'école des Beaux-Arts. Là, il decouvre vraiment la photographie et réalise, sur commande, des portraits de célébrités comme Man Ray, Marcel Duchamp ou Le Corbusier, mais aussi de portraits personnels, qui, aujourd'hui, sont d'indéniable icônes de ces atristes qui ont marqué le siecle. De 1946 à1954, il vit et travaille à Paris, tout en poursuivant ses etudes d'art à Paris , mais aussi Faenza et Florence. En 1950 ( jusqu'en 1953 ), il rejoint le groupe Fotoform pour la photographie subjective allemande de l'allemand Otto Steinert. En 1956, il s'installe à Paris où il restera jusqu'en 1962. Durant ces 6 ans, il produit son grand oeuvre sur les transexeuls de La Place Blanche. En 1962/63, il voyage au Japon, en Inde, aux Etats-Unis et en Afrique. De 1962 à 1974, il dirige l'École de Photographie de l'Université de Stockholm et forme plus de 1200 élèves dont l'élite de la photographie scandinave actuelle. Depuis, les photographie des Christer Strömholm sont exposées et éditées en Suède, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Mexique et Argentine
ON VERRA BIEN. En majuscules et sans ponctuation, en gros caractères d'imprimerie sur papier brun, ces trois mots, protégés par un cadre en format panoramique, ont accompagné Christer Strömholm sa vie durant. D'appartement en maison, de ville en ville, et jusque dans sa chambre d'hôpital.
Comment interpréter cette affirmation qui pourrait tout aussi bien donner une ligne de conduite au regard que signifier, avec cette forme si particulière de distance qui caractérise l ‘œuvre, un certain détachement, fondé sur la liberté davantage que sur une forme de résignation face à ce qui pourrait advenir ? Certainement - et cela correspond bien aux périodes parisiennes de Strömholm – comme une rencontre, un croisement plutôt, d'existentialisme et de surréalisme.
Ces qualificatifs, a priori, s'appliquent mal à un corpus plus visuel que littéraire et qui s'affirme comme explicitement et volontairement documentaire. Pourtant, tant dans la façon de s'intéresser aux « bizarreries » du quotidien, à la présence des objets - chez l'artiste Louis Pons, entre autres, ou bien au Marché aux Puces ou dans les cimetières – que dans la façon, unique, de dépasser l'anecdote du réel pour la transcrire dans une image tendue vers le sublime, l'absolu, on trouvera les correspondances avec un André Breton ou un Giacometti dont il réalisa des portraits définitifs. Dans la façon de photographier les travestis et transsexuels de la Place Blanche, en nous faisant côtoyer leur intimité sans jamais nous autoriser à aucun voyeurisme, en soulignant davantage l'énergie, la tendresse et les émotions de « ces filles dont le malheur a voulu qu'elles naissent dans un corps de garçon », Christer Strömholm exalte la liberté - à commencer par la sienne propre – d'êtres qui choisissent de construire, au quotidien, leur vie et leur identité, fût-elle en totale contradiction avec les conventions et les normes.
Dans le parcours de ce voyageur dont on soulignera souvent les trajectoires apparemment contradictoires, Paris occupe, à l'évidence, une place centrale. Celui qui sembla, toujours, fuir sa Suède natale pour visiter l'Allemagne (Dresde, où il est, dès 1937, un fervent défenseur de Paul Klee et du Bauhaus pourchassés par les nazis, pour suivre les enseignements de Waldemar Winckler), l'Espagne de la Guerre Civile en 1938, le Japon, l'Inde, l'Afrique et les Etats-Unis en 1962-63) est également le formateur, tant son enseignement, à partir de 1956, a été intense, généreux et efficace, de trois générations de photographes scandinaves dont les plus brillants (Anders Petersen, Lars Tunbjörk, J.H. Engström) rendent toujours hommage à leur professeur.
Dans cette traversée de l'espace, Paris est plus qu'une étape. Si, en 1937, il ne fait que passer, en route vers l'Espagne déchirée et avant de rendre visite, à Arles, à l'un de ses maîtres, le peintre Dick Beer, celui qui pratique alors la gravure avec une indéniable finesse sait déjà que la « ville lumière » sera un de ses territoires. Ce n'est qu'après la guerre, après qu'il ait mené le combat contre les troupes allemandes, de 1940 à 1945, en Norvège, alors qu'il n'a pas encore trente ans, qu'il s'installe à Paris où il suit les cours de l'Ecole des Beaux-Arts et qu'il découvre vraiment la photographie. Il va d'abord, tout en explorant les possibilités d'un médium dont il comprend très vite que, davantage que la peinture ou la gravure, il correspond au type d'exploration du monde qu'il veut développer, en faire un gagne-pain. En réalisant, pour la presse, des portraits d'artistes. Man Ray, Marcel Duchamp, Le Corbusier, entre autres. Caractéristique de sa recherche, à côté des commandes souvent formelles, il réalise des portraits personnels, qui, aujourd'hui, sont d'indéniables icônes de ces artistes qui ont marqué le siècle.
Son appartenance, entre 1950 et 1953, au groupe Fotoform (pour la photographie subjective) de l'allemand Otto Steinert semble une parenthèse, tant son approche échappe toujours à tous les formalismes et tant il semble peu adapté à l'idée même d' « école ».
De retour à Paris en 1956, il s'installe pour six années durant lesquelles il produit son grand œuvre de La Place Blanche tout en précisant ses positions théoriques quant à la photographie, à la notion d'engagement personnel, à la responsabilité éthique de celui qui explore le réel.
Il nous faut ici, revenir sur la notion de documentaire. Inventée pour « reproduire de la façon la plus fidèle et la plus rapide », la photographie s'est à ses débuts, donnée comme une empreinte mécanique et objective du réel. Une image au « réalisme » tel que l'on pouvait la confondre avec son référent préexistant dans le monde en trois dimensions auquel elle semblait se substituer. Très tôt, les photographes ont su que cette image que l'on consommait comme une « forme » de vérité n'était, en fait, que le point de vue subjectif de celui qui se trouvait derrière l'appareil et que l'opérateur, par ses choix de cadrage, par sa décision quant à l'optique, à l'instant du déclenchement et au type de composition proposait davantage un questionnement du monde qu'une affirmation transposée de celui-ci. Pour des raisons historiques, une des modalités du documentaire, liée à l'apparition du Leica et à la personnalité brillante d'auteurs tels que Henri Cartier-Bresson et Capa, le genre documentaire est devenu synonyme de reportage, d'instantané, d' « Images à la sauvette » régies par le principe de « l'instant décisif ». Ce qui s'est résumé dans l'importance accordée, pour des photographies prises « sur le vif » dans la valorisation de la géométrie fondée sur le classicisme du « nombre d'or » et par-delà cet aspect purement formel, de l'habileté du photographe à « dégainer » au bon moment. Au même moment, Outre-Atlantique, une autre tradition du documentaire, apparemment plus humble dans sa facture, vraisemblablement plus profonde dans sa façon d'explorer le réel pour rendre compte de ses structures, se développait. Walker Evans en est l'exemple le plus abouti et le plus complexe.
Lorsque l'on constate que les photographies parisiennes de Christer Strömholm ne ressemblent en rien à celles de ses contemporains français, il est tentant de le rapprocher de la tradition américaine. Chez Stromhölm, on ne trouve rien de comparable au charme et aux anecdotes d'un Robert Doisneau, d'un Izis, d'un Edouard Boubat, par exemple. Et l'on ne trouve aucun exemple de cette obsession pour la géométrie et le formalisme qui fonde l'œuvre de Cartier-Bresson. Les séries de portraits des travestis, dans leur simplicité respectueuse et émue, l'utilisation des lettrages en néon de la rue, y compris avec leurs réflexions sur les automobiles du quartier de ¨Pigalle, la capacité à aborder frontalement les sujets, sans aucun effet, évoquent immanquablement Walker Evans. Mais un Walker Evans européen, plus émotionnel que l'Américain, et qui nous guide, par certaines images, vers l'œuvre d'un Robert Franck des débuts. Bien plus que « l'instant », ce qui est décisif dans cette photographie-là est le choix du photographe. Le choix d'un point de vue, y compris physique (de ce point de vu les fuyantes de Christer Strömholm sur un paysage urbain enneigé ou sur l'enfilade d'une avenue sont vraiment remarquables. Choix, également, de la lumière, centrale essentielle au point que l'on pourrait parler de « lumière décisive » comme structurellement fondatrice du travail. Des lumières qui ne sont jamais spectaculaires, ni vraiment franches, mais qui, dans un entre-deux subtil, modèlent et révèlent les architectures comme les corps, leur donne grâce et élégance, avec ce qu'il faut de discrétion pour que le photographe s'efface, en témoin délicat, derrière ses modèles ou ses motifs. Bien que la tonalité soit différente, il n'y a guère que de celui de Brassaï - avec qui il fut amiD que l'on pourrait rapprocher le regard de Christer Strömholm. Et pas seulement à cause de la nuit, traversée par le désir et le sexe, ou de l'attention aux graffitis, aux signes d'une ville à déchiffrer attentivement, entre un cœur gravé sur un mur, un appel au « Non » au référendum gaulliste et une affiche maculée du Général. À cause, également, de cette commune décision de fuir l'anecdotique : dans les deux cas, l'anecdote est un moment du réel et non un ressort, séduisant, voire amusant, de l'intérêt que l'on porte à l'image et, qui, finalement, se révèle à la fois charmant et superficiel.
S'il est évident qu'elles n'ont rien de superficiel, les photographies de Christer Strömholm captivent par leur capacité de résistance à la glose, à la littérature, par une mystérieuse énigme qu'elles placent sous nos yeux et se refusent à expliciter. Elles nous disent simplement : cela fut et je l'ai vu ainsi. Je l'ai vu, regardé, et je l'ai versé à cette étrange éternité d'un temps strictement photographique, un temps qui s'étend entre l'instant de la prise de vue et le moment où vous regardez, pour que cette image devienne votre réalité, contemporaine alors que le réel qui l'a engendrée n'est plus depuis tellement longtemps.
C'est ainsi que les images d'un Paris disparu ne font pas appel à notre nostalgie mais éveillent notre curiosité et soutiennent notre intérêt en tant que document. Comment expliquer autrement que nous puissions, aujourd'hui, contempler avec plaisir aussi bien les toiles peintes des boutiques foraines de Pigalle que le « portrait » d'un serpent entravé ou la pose mutine d'un jeune travesti ?
Un autre élément, incontestablement, influe sur notre fascination pour la vision de Christer Strömholm : elle est mue par une gravité et un sens de la responsabilité face à l'autre peu communes. Dans aucune des images des travestis et des transsexuels n'affleurent jamais ni la vulgarité, ni la grivoiserie, y compris, et cela est particulièrement remarquable, dans les nus ou les moments de caresses et d'intimité.
L'absence d'anecdote souligne la façon dont l'œuvre est habitée par le sentiment de la mort. Il est vraisemblable que le suicide du père, alors que l'auteur n'avait que seize ans, a eu son influence. Mais le sentiment précoce de la finitude inéluctable de l'aventure humaine amène Strömholm, au-delà de sa passion pour les cimetières et les objets détériorés, à voir venir la mort dans le visage et l'expression d'une fillette derrière les barreaux d'une fenêtre ou dans le jeu, finalement si triste, d'un petit couple d'enfants prématurément vieillis. Les images d'enfants de Christer Strömholm, une fois encore tellement éloignées du charme et de l'anecdote qui ont fait le succès du « romantisme à la française » sont tout à la fois généreuses et respectueuses et d'une infinie tristesse.
Documenter le monde, au-delà de sa superficie visible, en questionner les enjeux, tout cela sur fond de scepticisme sans désespoir et de généreuse tristesse a été l'œuvre d'un demi-siècle de pratique photographique incessante, éclectique, boulimique parfois. C'est que, pour Christer Strömholm, l'enjeu était évidemment d'aller au plus profond des choses, sur le monde et, aussi, sur la photographie qu'il apprenait sans cesse à maîtriser, à explorer à tenter de cerner et de comprendre. Lui qui a su choisir une lumière fondatrice de son œuvre a été, naturellement, obsédé durant toute sa vie par le fait qu'une photographie est une interprétation, savante, du négatif réalisé en un instant. D'où la fonction essentielle du tirage chez un artiste qui, lorsqu'il tentait d'obtenir les contrastes très particuliers qu'il expliquait à ses assistants, devait se souvenir de sa pratique de graveur. La prise de vue, finalement, n'est qu'une anecdote qui ouvre la possibilité d'une image telle que le photographe l'a imaginée, transcendant le réel tout autant qu'elle l'atteste.
Au moment où la photographie atteint son autonomie, son âge adulte, où les fausses catégories entre « documentaristes » et» artistes » explosent enfin, où l'on découvre que, d'Atget à Jakob Tuggener, de Ricard Terré à Gotthard Schuh une photographie documentaire européenne, aux enjeux longtemps masqués par les formalismes du reportage au Leica ou par les formalismes russes et allemands, l'œuvre de Christer Strömholm apparaît comme centrale. Durant un demi-siècle, absolument livre, volontaire et entêté, il a tracé son sillon, en solitaire. Nul doute que, aujourd'hui, il prenne la place majeure qui lui revient dans la perception des enjeux de cette « image argentique » qu'il a servie autant qu'il l'a analysée.
On verra bien …
Christian Caujolle*
Juin-juillet 2001
* Directeur de l'Agence VU et de la galerie du même nom.
© Christer Strömholm
Box Galerie 102 chaussée de Vleurgat 1050 Bruxelles Belgique