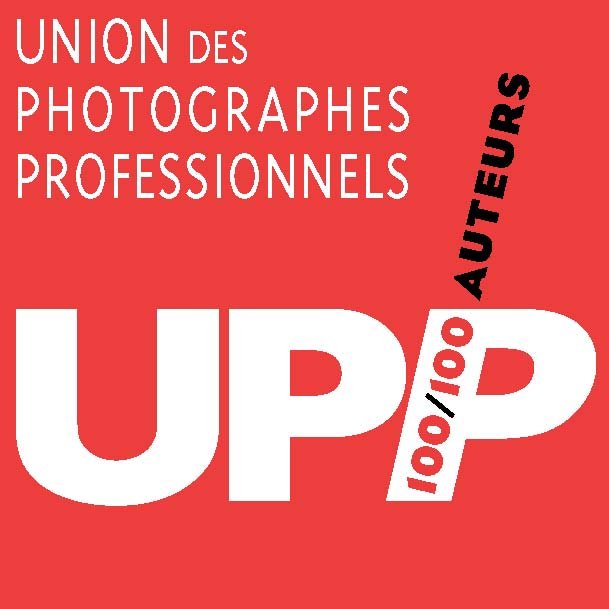
OUI a la proposition de loi 441 visant à faire cesser la pratique sauvage du DR, à faire payer les usages professionnels des photographies et à soutenir financièrement la création photographique en France
1 - Pourquoi le crédit DR est illégal ?
Parce que le fait de ne pas réussir à identifier l’auteur d’une photographie ou ses ayants droit ne justifie pas de l‘utiliser. Le Code de la propriété intellectuelle (article L.122-9) prévoit seulement la possibilité de saisir un juge et de lui demander l’autorisation d’utiliser l’oeuvre. Le juge n’acceptera que si la demande est justifiée par un motif légitime et il exigera généralement qu’une redevance soit versée au titre des droits d’auteur entre les mains d’une société de gestion collective des droits d’auteur. Le fait d’utiliser une oeuvre à des fins professionnelles sans autorisation est un acte de contrefaçon.
2 - Alors pourquoi la pratique du DR s’est-elle autant répandue en France ?
Parce que les organisations de photographes, à commencer par l’UPC (devenue UPP) n’ont pas été entendues. Mener des procédures judiciaires aurait été long, couteux et surtout inutile vu le nombre des utilisations concernées. La réussite de ces procédures aurait été incertaine car agir en justice au nom d’une personne non identifiée n’est en principe pas « recevable » par un tribunal.
3 - Qu’est ce qu’une « oeuvre orpheline » et comment éviter de traiter comme une oeuvre « orpheline » des photographies dont l’auteur est identifiable ?
C’est une question importante car nous ne voulons surtout pas nuire à la liberté de chaque photographe d’autoriser ou non l’utilisation de ses oeuvres par des professionnels.
Par l’expression « oeuvre orpheline », on désigne l’oeuvre dont l’auteur ou tout ayant droit d’un auteur décédé n’a pu être identifié ou retrouvé après des recherches sérieuses et avérées.
Ce sera à l’utilisateur de prouver qu’une photographie n’a pas d’auteur ou d’ayant droit identifié malgré des recherches sérieuses et avérées. Une fois la preuve établie de ses recherches, cet utilisateur pourra bénéficier de l’autorisation donnée par la société de gestion collective.
Par ailleurs, « l’orphelinat » des photographies doit être facilement réversible dès qu’un photographe ou un ayant de photographe se manifeste ou que cette personne est retrouvée. La proposition de loi crée donc une procédure simplifiée de « réversion » qui fait sortir les oeuvres concernées du mécanisme de gestion collective obligatoire.
La société qui va gérer les droits sur les oeuvres orphelines va développer un outil d’information publique en ligne qui permettra de faciliter et d’élargir les recherches.
Elle va gérer d’importantes bases de données et utiliser des outils numériques de reconnaissance des images.
4 - Qu’est ce que la gestion collective obligatoire ?
C’est un système juridique qui impose que les autorisations soient délivrées ou que les redevances soient collectées par une société de gestion collective et non individuellement par les titulaires des droits.
On trouve des exemples de ce système dans le Code de la propriété intellectuelle, en ce qui concerne l’exercice des droits sur la reprographie, le prêt public des livres, la copie privée, la câblodistribution simultanée des programmes hertziens de télévision et la communication au public des phonogrammes du commerce.
Dès lors qu’une oeuvre est réellement « orpheline », son auteur est empêché d’exercer ses droits car il n’est pas identifiable en l’état des recherches faîtes.
L’obligation de gestion collective est donc la seule solution permettant de valoriser l’utilisation des photographies « orphelines ». Mais dès que l’auteur ou un ayant droit apparaît, l’obligation de gestion collective prend fin et la personne concernée retrouve sa liberté d’exercer ses droits comme il l’entend.
5 - La société de gestion collective va-t-elle s’approprier l’argent pour les photographies dont on ne retrouve pas les auteurs ou les ayants droit ?
Tout d’abord, il est important de souligner que cette société devra répartir aux auteurs ou à leurs ayants droit les sommes perçues dès qu’ils auront été identifiés.
La proposition de loi conserve la durée de prescription de dix ans pendant laquelle toute personne concernée peut réclamer à la société le paiement de l’argent payé pour l’utilisation de ses oeuvres.
Par ailleurs, au terme de cette période de dix ans, la société de gestion collective aura l’obligation d’affecter l’argent à des actions d’aide à la création et à la diffusion photographique. La réponse est donc NON, la société de gestion collective ne va pas s’approprier cet argent. L’argent non réparti sera affecté au soutien de la création et de la diffusion photographique.
L’article L.321-9 du Code de la propriété intellectuelle rend possible de procéder à une telle affectation à l’aide à la création dès la cinquième année, mais dans des proportions qui ne mettent pas en danger l’obligation de paiement des titulaires de droits qui se manifesteraient ou seraient retrouvés avant le terme des dix ans.
La société de perception et de répartition des droits aura des frais de gestion. Ces frais de gestion devraient être financés principalement par les produits financiers générés par les sommes non réparties et non encore affectées à l’aide à la création.
Les comptes de la société de gestion collective agréée seront contrôlés par la Cour des comptes (via la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits), par le ministère de la culture et par les auteurs qui en sont membres.
6 - Comment seront fixés les barèmes ?
La proposition de loi prévoit un mécanisme à deux vitesses : - d’abord par voie d’accords professionnels entre la société de gestion collective agréée et toute organisation représentative des utilisateurs (éditeurs, agences de publicité, entreprises de presse, etc.), ces accords professionnels pouvant être étendus à l’ensemble du secteur d’activité des utilisateurs concernés ;
- ensuite, à défaut d’accord professionnel, par voie de décision d’une commission réunissant les organisations concernées et présidée par un magistrat ; cette décision étant publiée au Journal officiel et donc applicable à tous.
Le fait de soumettre ces utilisations de photographies à des barèmes de rémunération qui soient équitables aura un effet vertueux pour l’ensemble des usages non exclusifs de photographies par des professionnels.
La gratuité, acceptée ou pas, s’est répandue au préjudice des photographes ;
particulièrement depuis le développement des plateformes de vente en ligne « libre de droits »
Il est temps que la valeur de la photographie, même utilisée à titre non exclusif et quelle que soit la nature des usages professionnels, soit prise en compte et protégée.
7 - Comment la société de gestion collective peut-elle intervenir pour faire payer les utilisateurs ?
L’oeuvre « orpheline » n’ayant pas d’auteur ou d’ayant droit connu ou retrouvé, il est nécessaire de considérer qu’elle est protégée par les droits d’auteur dès lors qu’elle fait l’objet d’un usage public ou professionnel.
La société de gestion collective sera donc habilitée statutairement à intervenir auprès des utilisateurs quand une photographie est reproduite ou communiquée au public sans mention du nom du ou des auteurs qui en ont la paternité et quand cet utilisateur n’est pas en mesure de prouver que cette oeuvre n’est pas « orpheline ». De même, la société de gestion collective agréée sera habilitée à agir en justice contre ces mêmes utilisateurs pour faire payer ce qui est dû en application du barème applicable. Il restera possible pour l’usager de prouver que l’oeuvre orpheline n’est pas protégée et doit être exemptée de ce fait du paiement des sommes dues au titre de l’utilisation des oeuvres orphelines.
8 - La société de gestion collective agréée est-elle un établissement public ?
Non, bien qu’elle accomplisse une mission d’intérêt général. C’est une société civile soumise à un encadrement juridique contraignant qui est défini par les articles L.321- 1 et suivants et R.321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les associés d’une telle société sont les auteurs eux-mêmes.
9 - Deux points de détail dans le texte officiel sur le site du Sénat 1 / Dans l'exposé des motifs article 3, il est écrit "à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes," il s'agit d'une référence à la loi existante. Dans le cas de la photographie, il s'agirait bien sûr de soutien à la diffusion et la formation des photographes.
2/ Dans la proposition de loi, une coquille dans le chapitre 1er "oeuvre virtuelle orpheline" alors qu'il faut lire "oeuvre visuelle orpheline" bien sûr.

