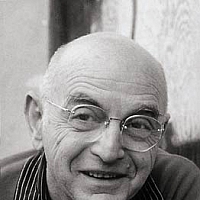Musée de la photographie de Charleroi Avenue Paul Pastur, 11 6032 Mont-sur-Marchienne Belgique
Duane Michals ou le présent composé
Rares sont les portraits de René Magritte qui ressemblent autant au peintre que celui qu’en fit Duane Michals à Bruxelles en 1965 : son corps s’inscrit dans le rectangle d’une toile posée sur un chevalet, la silhouette au chapeau melon s’effaçant dans la lueur d’une fenêtre qui l’aspire jusqu’à la dissoudre ; sur la chaise, le coussin a gardé l’empreinte de son corps, mais il n’est déjà plus là, fantôme traversé d’objets. Derrière le chevalet, le décor se prolonge sans interrompre ses lignes, comme dans le tableau La condition humaine. Seul, à gauche, le miroir a conservé indemne l’image de Magritte regardant œuvrer le photographe, victime et témoin de sa propre disparition. Composé comme le tableau d’un primitif flamand, la photographie déroge ici à la fraction temporelle, à l’instant extrait autant qu’à la tradition classique du portrait : c’est un temps composé, concen- trant dans le décor d’une chambre divers moments reliés au personnage qui en est le sujet, à sa présence plus qu’à ses traits, un portrait démultiplié par les points de vue.
Un autre portrait d’un autre peintre surréaliste, Giorgio de Chirico, le montre assis dans un salon bourgeois lisant un journal tandis que son chien sommeille ; ici encore, le visage disparaît dans l’éclairage de la fenêtre qui l’encadre, le rendant à peine reconnaissable : la même scénographie est appliquée au sculpteur Joseph Cornell, se déplaçant à contre-jour, entre fenêtre et miroir, évoquant autant son portrait par Lee Miller qu’une sculpture longiforme de Giacometti, sa silhouette amenuisée par le mouvement.
L’intérêt porté à ces trois artistes – l’on pourrait ajouter les exemples de Marcel Duchamp, Andy Warhol ou Willem De Kooning – ne témoigne pas seulement de son admiration à leur endroit mais aussi d’une volonté de confronter ces praticiens des arts de la durée – la peinture, la sculpture – à la discipline de l’art de l’instant – la photographie –, celle-ci se fondant en celle-là, sans aller vers un mimétisme réducteur ou l’abandon d’une technique. Mieux que la volonté de représenter leurs traits, Duane Michals entreprend de photographier leur pensée, ce «portrait de l’âme» qu’évoquait Nadar, leur offrant une représentation inédite ; ils sont ce qu’ils sont, ce qu’ils ont été et déjà ce qu’ils deviendront, et le photographe même.
«L’intérêt pour la mort est chez moi obsessionnel, écrit Duane Michals1. D’une certaine façon, je me prépare à ma propre mort». L’on pourrait ici évoquer des personnages non tournés vers le spectateur ou le photographe, mais vers eux-mêmes, vers leur propre existence et leur destinée, tel François Truffaut se faisant face dans les miroirs d’une chambre d’hôtel à New York, trois mannequins hiératiques à la chevelure de grand duc.
Il s’agit donc pour Duane Michals d’étendre les possibilités de la photographie, en se gardant de l’influence directe de la peinture ou du cinéma, en s’échappant du photomontage comme du traditionnel roman-photo – souvent un film arrêté sur image – en se situant précisément entre toutes ces catégories. Montrer ce qui est derrière, ce qui est caché, ne pas se contenter d’une image unique, être ici et là, l’instant d’après et l’instant d’avant réunis au sein d’un même espace – l’atelier, le salon, la chambre – par la surimpression ou les reflets, par la séquence photographique dont Duane Michals s’est abondamment servi dès la fin des années soixante. Ces historiettes développent sur quatre, cinq, six ou huit images – lesquelles sont souvent redoublées par surimpressions – une continuité narrative qu’un texte calligraphié au bas parfois accompagne, comme la légende d’une illustration pour compléter l’image. L’espace est rarement clos : la fenêtre centrale est un puits de lumière plutôt qu’un balcon et le livre, le tableau, le miroir, disposés dans le champ sont autant d’échappées à l’image même, de perspectives pour s’y enfoncer ; l’image est aussi dans l’image, emmenant vers celle qui suit autant qu’en ses tréfonds, croisant les fantômes, les générations, en paraboles de l’âge aux accents mythologiques s’il n’y avait l’humour de Duane Michals, la beauté et la sensualité de ses modèles aux visages d’anges, égarés dans des décors quotidiens, tombés dans des chambres pour disparaître ensuite dans ce halo qui fait ailleurs des photographies voilées, mais pas chez Duane Michals.
Des contes éveillés, des rêves à faire peur, des histoires à ne pas dormir du tout dans des chambres étroites comme des maisons de poupées, avec ces fenêtres brûlées de jour, des anges dénudés navrés de ressembler autant aux humains, de succomber à leurs tentations, des esprits quittant leurs corps, des maisons que la mémoire restitue intactes, avec ceux qui les ont habitées, qui ne sont plus, ces proches et ces familiers dont les objets témoignent encore, si nets dans le souvenir comme au réveil d’un beau rêve qu’on croirait leur avoir parlé, les avoir touchés, avoir aboli la mort comme Peter Ibbetson retrouve Mimsey.
Duane Michals photographie le temps qui s’écoule comme les grains dans le sablier, comme pour déjouer la mort, pour se voir mort mais voir encore, une mort toujours au présent, en des photographies pour prolonger la photographie, un passeport pour dépasser le temps.
Xavier Canonne