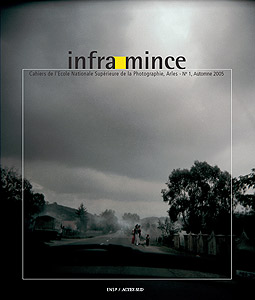
Infra-Mince est une nouvelle revue lancée à l'automne 2005. Co-édité par l'ENSP et Actes-Sud, le premier numéro propose aux lecteurs des histoires et des récits parlant, directement ou indirectement, d'une institution - l'École Nationale Supérieure de la Photographie - dont on célèbre en 2005 le vingtième anniversaire de la première promotion. Il y est question de photographie - évidemment -, de photographes - non moins évidemment -, mais aussi de métiers et de professions ayant pour la plupart une relation avec les images fixes ou animés et auxquels l'enseignement dispensé par l'École permet d'accéder.
Des anciens étudiants en majorité mais également des membres de l'équipe pédagogique, des fondateurs, des administrateurs, des directeurs, ancien et actuel, des partenaires de l'École actifs en France ou à l'étranger s'y expriment, les uns parlant librement de leurs expériences, de leurs souvenirs, de leur rapport à la photographie, de leurs passions ou de leurs attentes, d'autres montrant au fil des pages quelques unes parmi leurs images.
Ce numéro inaugural a donc pour objectif de présenter l'École à ceux qui la connaissent peu ou mal. Il ne prétend pas rendre compte de tous les aspects d'un établissement dont la discrétion n'empêche pas qu'il soit doté d'une vie intense, mais donner un échantillon de ce que, dans un ensemble de domaines très divers, son enseignement a pu produire au cours de vingt-trois années d'existence. Il est susceptible d'intéresser tous ceux qu'intriguent le devenir de la photographie et le destin des images ainsi que les lieux dans lesquels on fabrique et on interroge les unes et les autres
Les numéros suivants, à raison d'un par an, reprendront ces interrogations en s'appuyant sur les recherches conduites dans l'École et hors d'elle. Il maintiendra naturellement un lien avec les activités de l'institution elle-même et avec celles d'anciens étudiants mais il s'en évadera pour explorer tout ce qui, de près ou de loin, peut retenir l'attention des amateurs et des connaisseurs en matière de photographie, celle aussi des chercheurs et de tous les esprits curieux des choses de notre temps.
**************
EXTRAIT DE TEXTE
Erik Bullot
(...) La brièveté de l'expérience photographique dans la biographie de certains artistes ou savants est frappante. Après quelques années de pratique intense, parfois fébrile, d'invention et de mise au point de différentes techniques, de déclinaison singulière d'un répertoire de motifs, le médium photographique est délaissé pour d'autres préoccupations : théorie des ensembles, déchiffrement des hiéroglyphes, littérature, etc. Je pense ici, bien sÛr, à William Henry Fox Talbot et Lewis Carroll. La photographie semble se révéler sous le sceau exclusif de la soudaineté. Le noyau obscur d'une œuvre (mais peut-on encore parler d'œuvre au sens traditionnel ?) se trouve révélé et cartographié sur un laps de temps relativement court. Est-ce faire preuve d'excès de romantisme que d'observer une même fulgurance temporelle chez certains photographes qui, contrairement à Talbot ou Carroll, n'ont jamais totalement délaissé le médium photographique ? Les premières images de Cartier-Bresson en Espagne ou au Mexique ou l'aventure de la FSA pour Walker Evans semblent relever d'expériences décisives où se dessinent avec intensité les traits déterminants de la formation d'un style. Même s'il est possible de deviner dans les dernières images d'Evans une anticipation fine et subtile de nombreuses pratiques de l'art contemporain, l'intensité de la “première fois” reste saisissante. La photographie est-elle marquée par une force de fulguration qu'il s'agit dès lors de conjurer ? En apposant par contact des plaques de verre sur son ruban de pellicule pour le Retour à la raison en 1923, Man Ray a fait du film, au sens littéral, avec de la photographie. Le cinéma aura-t-il été l'une des arêtes, sans doute la plus aiguë, de la photographie ? La brèche grâce à laquelle la question de la soudaineté trouvait enfin sa relève ? Le film est-il l'accélération de la photographie, pour reprendre l'expression de Marshall McLuhan ? (...)
> Plus de détails sur : http://www.ensp-arles.com/inframince.htm

